Médicaments anti-obésité : le marché de l’agroalimentaire menacé
Face à l’essor des médicaments coupe-faim, un rapport de Roland Berger prévoit un recul substantiel de certaines dépenses alimentaires. Qu’en est-il en France ? Regard croisé entre deux senior partners de Kéa spécialisés respectivement dans la santé et la grande consommation.

Une révolution sanitaire qui s’inscrit dans le sens de l’histoire
C’est la théorie des dominos. Au départ, la découverte d’un traitement pour le diabète de type 2, approuvé par la Food and Drugs Administration (FDA) en 2005. Une molécule ciblant les récepteurs d’une hormone, appelée GLP-1, et stimulant la sécrétion d’insuline tout en coupant la faim. 20 ans plus tard, le groupe Mars annonce des investissements massifs en Europe pour anticiper une baisse de son chiffre aux États-Unis. Entre les deux, les médicaments GLP-1 ont été repositionnés pour traiter l’obésité, 4 molécules obtenant l’approbation de la FDA en ce sens entre 2014 et 2023.
Le marché, entièrement dominé par Novo Nordisk et Eli Lilly, explose au début des années 2020. « 12 % des Américains ont déjà suivi un traitement GLP-1 », explique Jörg Ohleyer, senior partner chez Kéa et spécialiste du secteur santé. On parle déjà d’un recul des chiffres de l’obésité aux États-Unis. Dans le même temps, les industriels de la sucrerie et du snack commencent à redouter un recul de leur chiffre d’affaires. « Les médicaments GLP-1 coupent votre envie de manger du gras et du sucre, rappelle Christophe Burtin, senior partner Food&Retail, également chez Kéa. Quand on regarde tous les rayons concernés, on constate que la réduction de consommation pourrait aller jusqu’à 10-15 % ». Une étude du cabinet Roland Berger estime que les dépenses alimentaires pourraient baisser de 60 et 90 milliards de dollars à l’horizon 2031 suite à l’essor des traitements anti-obésité.
Dans ces conditions, quelles sont les stratégies possibles pour les grands acteurs concernés ? Pour Jörg Ohleyer, « l’idée, avancée par certains producteurs, de compenser ces pertes aux US en se développant sur le marché européen est une impasse stratégique. Dans l’agroalimentaire, il y a une tendance de fond depuis au moins une dizaine d’années – voire plus pour certains acteurs : c’est celle qui consiste à promouvoir une alimentation tournée vers la santé, une alimentation plus responsable. L’avènement du bio fait partie de ce mouvement. »
Le tableau, cependant, est à nuancer, selon Christophe Burtin. Certes, « la promotion de l’alimentation saine monte en puissance. Mais, comme toute tendance, elle s’accompagne de sa contre-tendance, à savoir le food porn ». Ces deux mouvements ne s’excluent pas nécessairement : « Je vais faire attention à ce que je mange chez moi, puis me “lâcher” au restaurant. Pour le moment, le match se décide plutôt en faveur du food porn : le gras et le sucré se vendent bien. Une bonne partie du résultat des entreprises provient de ces produits. »
La vague GLP-1 arrive en Europe
Outre le fait que les marchés européen et américain sont très différents, ni les acteurs de la santé ni ceux de l’agroalimentaire ne semblent particulièrement craindre les répercussions en Europe de décisions prises outre-Atlantique par les grands producteurs de snacks et de sucreries. En revanche, les enjeux de l’essor des médicaments anti-obésité sur le sol français et européen sont très présents dans les esprits.
Pour Jörg Ohleyer, il n’y a guère de doute : « La vague GLP-1 arrivera en Europe. Les industriels pharmaceutiques ont à vrai dire surtout peur de la hauteur de cette vague : plus la consommation sera massive, plus les risques que se produisent des effets indésirables augmenteront », au risque de discréditer la molécule. Le scandale du Mediator est encore dans tous les esprits.
Pour le moment, en France, l’accès aux traitements à base de GLP-1 est limité. Ces médicaments ne sont remboursés que dans le cas de traitement du diabète de type 2. Ils peuvent en outre être prescrits en traitement contre l’obésité, mais sans remboursement, si le patient présente un IMC supérieur à 30, ou supérieur à 27 avec au moins une comorbidité. Et ce, uniquement si les autres formes de traitement n’ont pas fonctionné. « Depuis cet été, ajoute Christophe Burtin, les généralistes peuvent prescrire les médicaments GLP-1. Or, 18 % de la population française est potentiellement concernée. »
Un facteur important sera le coût du traitement et son remboursement. « Aux États-Unis, il y a 40 % d’obèses, mais le traitement n’est pas remboursé. Le prix va rester un frein. » Même si Donald Trump a annoncé récemment avoir négocié avec les laboratoires pour abaisser le coût de ces traitements à 350 $ par mois, voire, dans un second temps, à 150 $. « En France, précise Jörg Ohleyer, le traitement représente un coût d’environ 160 € par mois. »
Dans la décision de rembourser ou non, le coût du traitement et les effets secondaires ne sont pas les seuls paramètres. « Dans la balance bénéfice-risque, il faut prendre en compte l’impact pour la société, la prévention des maladies cardiovasculaires… Le temps passé dans les hôpitaux en conséquence des pathologies liées à l’obésité coûte cher. » On parle de 10 Mds € par an.
Baisse des volumes et alimentation santé : 2 tendances de fond
À terme, il paraît donc inévitable que les traitements contre l’obésité gagnent du terrain, au détriment de la part « food porn » du marché agroalimentaire. « L’industrie de l’agroalimentaire est dans une réinvention de sa proposition de valeur, selon Jorg Ohleyer. La filière sucre se pose la question du rôle qu’elle joue dans la promotion du bien-être et de la santé. Même si les vases ne sont pas directement communicants, tendanciellement, le GLP-1 est un accélérateur du repositionnement du marché du sucre vers des produits plus sains. » Globalement, « il n’y a pas un industriel de l’alimentaire qui puisse se permettre de ne pas être partenaire de ce mouvement ».
Mais ce « mieux consommer » ne peut pas ne pas avoir pour pendant un « moins consommer », qui aura un impact, nécessairement, sur les ventes. « La baisse des volumes est un des nouveaux paradigmes de la grande consommation », analyse Christophe Burtin. Plusieurs facteurs y concourent. « En plus de l’aspect santé, il y a le sujet du paraître : le surpoids n’est pas bien vu. Et le vieillissement démographique devrait aussi avoir une influence à la baisse sur les quantités consommées. »
Comment les acteurs de l’agroalimentaire anticipent-ils ces évolutions ? Parmi les acteurs spécialisés dans les produits gras et sucrés, deux types de stratégies sont possibles : il y a « ceux qui vont chercher à refondre leur offre et leurs sources de revenus ; et ceux qui vont continuer à assumer et à développer les volumes. Tant que la vente de ces produits n’est ni interdite ni taxée, il n’y a pas de raison pour que la tendance au food porn s’interrompe ». Christophe Burtin fait ici allusion au vote récent d’un amendement à la loi des finances prévoyant la taxation des sucres ajoutés – taxe qui dépend de l’adoption définitive du budget pour être confirmée.
C’est pour s’inscrire dans la première de ces tendances – la refonte de l’offre et du modèle économique - que Kéa a pris l’initiative de réunir « des industriels de l’agroalimentaire, des assureurs, des mutuelles, pour promouvoir la prévention et une alimentation plus saine », nous expose Jörg Ohleyer, autour d’un projet commun d’aide à la maîtrise de son alimentation par le consommateur. Le projet phare en est une appli gamifiée d’évaluation et de suivi des apports nutritionnels qui, en plus de rendre service à ses utilisateurs, produit de la data pour nourrir la recherche et faire évoluer l’offre des industriels.
Pour Christophe Burtin, « les entreprises de l’agroalimentaire n’ont pas toutes pris la mesure du problème. Beaucoup se battent pour éviter les taxes ; elles se trompent de combat ». « Nous sommes convaincus que la réinvention des business de demain passe par un changement de logiciel stratégique, reprend Jörg Ohleyer. Nous ne pouvons plus nous reposer sur une segmentation par couloirs de nage séparés. Il faut rassembler les acteurs qui vont du care au cure, dans un combat commun en faveur du bien-être, de la santé, du “se sentir bien et beau”. Les frontières entre les secteurs sont de plus en plus floues. Et si le GLP-1 joue son rôle d’accélérateur des consciences, tant mieux. »

Un tuyau intéressant à partager ?
Vous avez une information dont le monde devrait entendre parler ? Une rumeur de fusion en cours ? Nous voulons savoir !
commentaire (0)
Soyez le premier à réagir à cette information
grande consommation - luxe
 08/01/26
08/01/26Lou Zalmanski poursuit son ascension chez Hermès. À la tête du conseil interne du groupe depuis 2019, elle a été nommée au sein d’Hermès Maroquinerie-Sellerie.
 17/12/25
17/12/25Pour accompagner sa stratégie digitale et renforcer son efficacité opérationnelle, le groupe anglais de luxe a promu 2 cadres internes, anciens du BCG et de McKinsey respectivement, à des postes exécutifs clés.
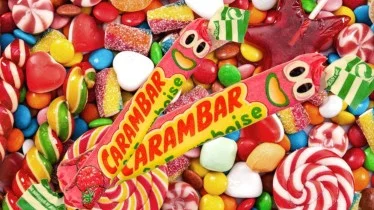 12/12/25
12/12/25Au premier semestre 2023, Kéa s’est vu confier l’accompagnement du groupe Carambar, alors détenu par Eurazeo. Christophe Burtin, senior partner, revient sur cette mission couronnée par la reprise du groupe par Ferrero en novembre 2025.
 26/11/25
26/11/25Associée du bureau de New York jusqu’à début novembre, Joëlle Grunberg prend la tête de Tory Burch pour l’Amérique du Nord.
 03/11/25
03/11/25Après 15 ans passés chez Mews Partners, dont 6 à sa tête, Stéphane Gautrot se consacre désormais aux vendanges. Avec son épouse et un œnologue, il cultive 4 hectares de vignes tout près de Gaillac, dans le Tarn.
 31/10/25
31/10/25Le fleuron du groupe, Gucci, sera évalué par Bain.
 24/10/25
24/10/25Après 26 ans passés chez Oliver Wyman, dont 13 comme associé, Éric Bach rejoint Arthur D. Little pour y piloter le développement de son secteur de prédilection.
 22/10/25
22/10/25Michel Sanson, expert du food service – ou consommation hors domicile –, interviendra auprès du pôle Consumer dirigé par Xavier Fontaine.
 12/09/25
12/09/25Consultant aux multiples facettes, Yann Kretz s’est arrimé chez Kéa début septembre – pour aider le cabinet à renforcer son empreinte dans le secteur du luxe.